Sabine Fos-Falque. La chair des émotions
(Cerf, 2014)
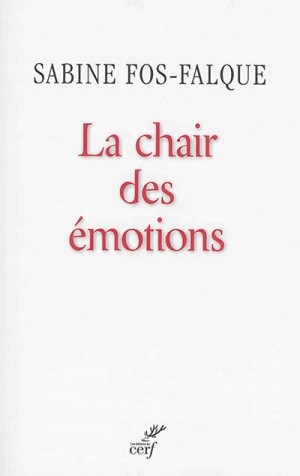 Les émotions ont une chair, elles qui nous traversent de part en part, secouent notre corps, courent tout au long de notre peau et comme pour mieux atteindre le tréfonds l’âme. Mais elles ont aussi besoin d’un verbe. Le beau livre de Sabine Fos-Falque le leur donne. Pour cela, il fallait avant tout trouver le ton juste, accompagner chaque émotion d’une écriture qui lui soit accordée, avec ce rien de distance qui permet de n’être pas submergé tout en restant au contact de la chose même. Comme toujours dans les choses de pensée, cette justesse de ton ou d’écriture n’est rien d’anecdotique. Pour certains sujets, dès qu’il est question du sensible ou de l’affect, la justesse de la phrase est vitale. C’est même là la condition sine qua non pour s’orienter dans la forêt des affects. Ce livre, il est vrai, est à bonne école, qui a pu s’entourer des meilleurs, les soutiens sans défaut – pour en citer quelques-uns, parmi ceux qui me sont le plus proches, Kafka, Pessoa, James, Quignard, Virginia Woolf, liste non close. Mais ce livre ne fait pas qu’importer des phrases, les siennes ont leur propre rythme qui pour être fidèles à ce qu’elles décrivent savent avancer et ralentir (La pensée, affaire de ton. L’écriture, affaire de rythme), avec parfois des pages entières qui se précipitent dans une phrase comme un fleuve se jette dans la mer (par exemple, et ce n’est là qu’un exemple : « Qui saurait arrêter la démesure du vent ? », p. 239) Il y a des livres qu’on aime pour une phrase, comment ne pas aimer celui-ci où il y a bien plus ? Et plus qu’un affluent. La littérature en est un, d’autres sont à citer. Ce livre est d’une psychanalyste. Certains se sentiront chez eux dans ces études de cas, mais que nul ne se sente étranger à ces pages parce qu’il redouterait une langue barbare (entendez par là : technique) : tout y écrit avec cette légèreté vraie qui n’est pas superficialité. Et parfois aussi, qui affleure – là encore, cette manière, l’affleurement, n’est pas indifférente à ce dont il s’agit – il y a la vie spirituelle, troisième affluent. Combien de pages savent dire avec retenue, n’imposant pas mais faisant signe, que nous n’avons qu’une seule aventure qui s’appelle vivre, et qu’il y faut tracer notre chemin, avec le corps et la vie spirituelle – peu importe qu’ici ou là ce chemin ne soit pas un segment de droite, parce qu’il ne l’est jamais.
Les émotions ont une chair, elles qui nous traversent de part en part, secouent notre corps, courent tout au long de notre peau et comme pour mieux atteindre le tréfonds l’âme. Mais elles ont aussi besoin d’un verbe. Le beau livre de Sabine Fos-Falque le leur donne. Pour cela, il fallait avant tout trouver le ton juste, accompagner chaque émotion d’une écriture qui lui soit accordée, avec ce rien de distance qui permet de n’être pas submergé tout en restant au contact de la chose même. Comme toujours dans les choses de pensée, cette justesse de ton ou d’écriture n’est rien d’anecdotique. Pour certains sujets, dès qu’il est question du sensible ou de l’affect, la justesse de la phrase est vitale. C’est même là la condition sine qua non pour s’orienter dans la forêt des affects. Ce livre, il est vrai, est à bonne école, qui a pu s’entourer des meilleurs, les soutiens sans défaut – pour en citer quelques-uns, parmi ceux qui me sont le plus proches, Kafka, Pessoa, James, Quignard, Virginia Woolf, liste non close. Mais ce livre ne fait pas qu’importer des phrases, les siennes ont leur propre rythme qui pour être fidèles à ce qu’elles décrivent savent avancer et ralentir (La pensée, affaire de ton. L’écriture, affaire de rythme), avec parfois des pages entières qui se précipitent dans une phrase comme un fleuve se jette dans la mer (par exemple, et ce n’est là qu’un exemple : « Qui saurait arrêter la démesure du vent ? », p. 239) Il y a des livres qu’on aime pour une phrase, comment ne pas aimer celui-ci où il y a bien plus ? Et plus qu’un affluent. La littérature en est un, d’autres sont à citer. Ce livre est d’une psychanalyste. Certains se sentiront chez eux dans ces études de cas, mais que nul ne se sente étranger à ces pages parce qu’il redouterait une langue barbare (entendez par là : technique) : tout y écrit avec cette légèreté vraie qui n’est pas superficialité. Et parfois aussi, qui affleure – là encore, cette manière, l’affleurement, n’est pas indifférente à ce dont il s’agit – il y a la vie spirituelle, troisième affluent. Combien de pages savent dire avec retenue, n’imposant pas mais faisant signe, que nous n’avons qu’une seule aventure qui s’appelle vivre, et qu’il y faut tracer notre chemin, avec le corps et la vie spirituelle – peu importe qu’ici ou là ce chemin ne soit pas un segment de droite, parce qu’il ne l’est jamais.
Un livre nous touche aussi parce qu’il rejoint, imprévisiblement, des pensées qui nous taraudent. Je les livre ici, sans chercher à les reconstruire, comme autant d’appuis pour moi-même et le travail que j’aimerais mener sur une phénoménologie de l’affectivité. En commençant par l’Ouverture (p. 11-13), magnifique, où il est question du frémissement de l’émotion et de l’équivoque du langage, c’est-à-dire où il est question de son mouvement du corps aux mots (ce qui n’est peut-être jamais que le mouvement d’un corps à l’autre, tant nous existons aussi d’un corps fait de mots et de langage). Ce qui est aussi le passage d’une équivoque (le trouble de l’émotion) à l’autre (car donner forme de langage n’est pas figer dans une forme, comme s’il fallait lui donner la même netteté de contour qu’un objet dans l’espace). De quoi s’agit-il, annoncé dans cette page, et repris ensuite de chapitre en chapitre ? D’accompagner ce mouvement, ou plutôt ce triple passage : du silence au langage, du secret à autrui, et du chaos à l’habitation (là où le bruissement se fait musique), mais sans aller trop vite, ou jusqu’au bout, sans forcer la surprise de l’émotion ou ce qu’elle garde d’incertain à se convertir (de négatif en positif, ce qui maintenant est posé-là, en son être-définitif), d’accompagner ce mouvement tout en lui gardant sa part d’incertain, celle qui appartient à chacun, celle que chacun d’entre nous est seul à pouvoir éprouver, « cette bascule de l’un à l’autre… mise au défi de toute tentation de simplification » (p. 12). Voilà ce qu’il faut arriver à dire, à chaque fois, de manière neuve. Et c’est le pari que toujours il y aura un passage, mais gardons-nous de croire qu’il suffirait de nommer le port, le point d’arrivée, pour y être. Voilà bien ce qui est en jeu !, ce risque et ce pari, et il faut l’un et l’autre, jusqu’au moment où nous éprouvons (car ce n’est rien de le dire, là où il faut l’éprouver, mais peut-être pour l’éprouver complètement avons-nous besoin de le dire, à nous-même et à d’autres – peut-être nous faut-il pour cela nos deux corps, de chair et de sang, et de mots), jusqu’au moment donc où nous éprouvons ce point de bascule, ce retournement. Alors, « du chaos des émotions à la beauté de leur mise en forme », il faut que la traversée se fasse en sourdine (p. 17). Il faut qu’elle se fasse, mais comme un travail souterrain et d’autant plus décisif. Après tout, la vie spirituelle n’est pas vie de surface. Et si l’enjeu de cette traversée est bien notre naissance (l’unique question, comme Rilke le savait : « Nous naissons pour ainsi dire provisoirement quelque part ; c’est peu à peu que nous composons en nous le lieu de notre origine, pour y naître après coup, et chaque jour plus définitivement », cité p. 16), celle-ci n’aura pas le caractère manifeste et même spectaculaire de cette naissance au monde qu’accompagne notre premier et magistral cri de nouveau-né. L’unique affaire, ce serait bien de « s’entendre venir au monde » (p. 262).
Encore n’ai-je lu que les premières pages, promesse du livre entier. Comment ne pas suivre le chapitre sur le commencement (p. 23-30) – ce chapitre si nécessaire sur le chaos. Car il va de soi que nous ne commençons jamais par le logos et la lumière, mais toujours plutôt par le chaos. Pourquoi il faut « regarder… et quitter… » (selon la forte maxime p. 28). Ni faire l’économie d’un tel commencement, ni rester dans la fascination – tâche doublement difficile et pourtant nécessaire. Mais comme le commencement n’est que le commencement, et ne présage en rien de ce qui doit venir (p. 29), il nous faut faire droit aussi à l’horizon de toute cette aventure. Que le dernier mot de cette trop courte note soit pour citer la dernière phrase du chapitre sur la joie. Et parce que la promesse d’une phrase parfois aide à vivre (une phrase, un tableau…) : « Seul celui qui sait de quels abysses il est issu peut éprouver l’exultation de l’apaisement, lorsque, à la question de l’À quoi bon vivre, lui vient enfin un chant » (p. 214).
Jérôme de Gramont
Dernières critiques
Jean Blot, Le rêve d’une ombre
Un mot insolite résonne comme un leitmotiv dans Le rêve d’une ombre de Jean Blot, deuxième volet de la trilogie « Histoire du passé » qui, après l’Egypte, nous plonge cette fois dans la Grèce ancienne : l’anthropophanie, qui désigne l’apparition de l’homme (anthropos) à la lumière de sa propre conscience…
Corine Pelluchon, Les nourritures
Plaidoyer pour un « cogito gourmand et engendré » (Éditions du Seuil, 2015)
Dans cet essai passionnant, Corine Pelluchon tente de répondre à une question des plus simples : Pourquoi, alors que nous en voyons la nécessité, ne changeons-nous pas de vie ? Pourquoi, alors que notre mode de vie court à la catastrophe, n’en changeons-nous pas ?
Matthieu Gosztola, Nous sommes à peine écrits
Éditions numériques Recours au Poème, 2015
Attention, voici un recueil à ne pas laisser passer ! Si j’étais a priori un peu réticent par rapport au principe des éditions numériques, je suis très reconnaissant envers les éditeurs de Recours au Poème de rendre possible la publication d’un tel recueil…
