La nécessaire gravité
Réginald GAILLARD, L’attente de la tour, Ad Solem, Paris, 2013
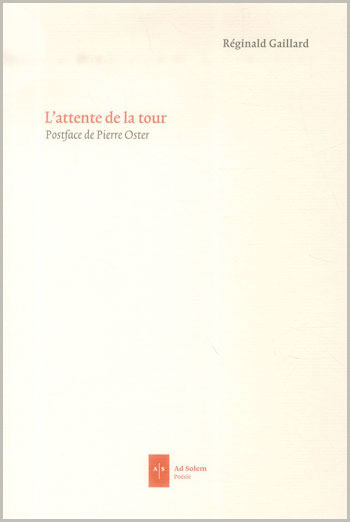 Le poème commence par la mort d’une jeune femme. Elle flatte l’encolure d’un cheval, lui donne un sucre, « puis glisse dans les plis de la mort et se couche, lasse / sur le flanc, dans l’herbe grasse, délicieuse, / – Prions. » Nous n’en sortirons plus. Au pas d’un vers empreint de sévérité et de haute exigence, nous marcherons sans un mot avec le récitant, portant la même douleur, longeant les mêmes tombes, traversant la chute sans fin qu’est le deuil. Une même gravité nous habille, qui fait s’évanouir la fausseté, les compromis de la paresse, la joie sans vie, les subterfuges lassants. Il ne reste que le froid de la mort et, à son toucher, le mystère noir de la vie. Plus loin, des tableaux. La ville inutilement mondaine. Et « une ombre passe dans mon regard », puis on en revient, « à la rugosité de la route, à la rigueur des hommes en bataille / à l’impossibilité de dire ce qui est ».
Le poème commence par la mort d’une jeune femme. Elle flatte l’encolure d’un cheval, lui donne un sucre, « puis glisse dans les plis de la mort et se couche, lasse / sur le flanc, dans l’herbe grasse, délicieuse, / – Prions. » Nous n’en sortirons plus. Au pas d’un vers empreint de sévérité et de haute exigence, nous marcherons sans un mot avec le récitant, portant la même douleur, longeant les mêmes tombes, traversant la chute sans fin qu’est le deuil. Une même gravité nous habille, qui fait s’évanouir la fausseté, les compromis de la paresse, la joie sans vie, les subterfuges lassants. Il ne reste que le froid de la mort et, à son toucher, le mystère noir de la vie. Plus loin, des tableaux. La ville inutilement mondaine. Et « une ombre passe dans mon regard », puis on en revient, « à la rugosité de la route, à la rigueur des hommes en bataille / à l’impossibilité de dire ce qui est ».
Il faut donc faire face. L’air a changé. L’heure présente s’est faite immobile. Il n’est plus possible de faire comme si de rien n’était. « Il ne sera plus temps d’errer alors au gré des longues rues. / Il ne sra plus temps de poser son regard sur l’arbre mort. / Il ne sera plus temps de croiser des yeux la contemplative. »
Passe l’homme « sans visage », un homme seul, « si calme qu’il rassure les fous. » Il avance, il ne cède rien, « son pas défriche ». Dans sa lutte, « il nourrit la mort » et offre face au récitant ses lèvres bleuies et sa « tête d’un trouvère / décapité sur scène en plein chant. » Et l’homme toujours avance, « il va loin, dans la maison qui n’existe pas / (…) Il va, dans la nuit, réciter ses prières oubliées. »
Puis on le perd cet homme – le vers est alors si intense, si noir et si froid que mes yeux ont dû reculer. Quand je les ai rouverts, j’ai retrouvé le récitant qui se parlait ou se confessait. « Épouse la bourrasque », se dit-il, et plus loin, « Et toi qui bouillonnes dans tes esquisses / prends patience, pas à pas », ou encore, « Écoute le temps du silence / on croirait le paradis. »
Alors le récitant se retourne vers la tour. Elle a brûlé. Des cendres et des pierres massives. Il « les regarde, atterré ; c’est moi qui ai mis le feu. » Il la restaurera, se dit-il, pierre à pierre, placera au sommet un autel « dédié au Seul, qui jamais ne trahit ». Alors, voici l’aveu qui monte, la douloureuse parole qu’il fallait dire et que tout le chemin ne faisait que porter depuis le début : « Seigneur (…) / passe ton épée sur le nœud de glace qui me retient et m’éloigne ». Après, l’après de l’aveu, vient non pas la délivrance, mais la chute, la chute sans fin. Porter un mort ou toucher l’infini est une seule et même chose. Et il n’y a pas d’échappatoire. Alors, tombe le dernier mot du poème : « Prions. » La beauté formelle du poème captive. Une poésie qui se fait héritière des expressionnistes allemands, de Grosjean, Reverdy et Frénaud peut-être. Longtemps après avoir refermé le recueil, la jeune cavalière, l’homme sans visage, la ville de Paris, la tour, continuent de travailler la mémoire par leur image, le vers aux notes sourdes et racées. Bien après, leur lancinant travail vient peupler nos interrogations de leurs ombres.
Plus encore, ils nous confrontent à notre responsabilité envers les morts. Tous, nous sommes appelés à porter, notre vie durant, un ou deux morts. Par eux, irrémédiablement, nos jours et nos nuits seront renvoyés à un arrachement, à un esseulement si vaste que notre solitude s’y brise infiniment. Peut-être que la raison d’être du mort que nous portons est d’inscrire notre existence dans un rapport nouveau où la vie et la mort ne font plus qu’un, où, dépossédés de nous-mêmes, nous somme jetés dans un mouvement de chutes et d’appels, comme l’écrit Pierre Oster dans la postface du livre.
Plus troublant, la dimension spirituelle et chrétienne du recueil redit que la foi n’est pas un vade mecum qui permet de traverser l’épreuve sans écueil. Au contraire, le poids de la mort, le dépouillement qu’elle réclame, la kénose éprouvée qui reconnaît le néant qui l’entoure, la mise en danger de soi plongent le vivant plus avant dans l’expérience de l’absence de Dieu. Croyant ou non, la main tendue vers le vide est la même. Elle nous rappelle le gouffre où toute vie est plongée. Significatif à ce titre est le discret hommage rendu à Kipling, errant entre les tombes à la recherche de son fils tombé durant la guerre 14-18. Il veut inscrire, malgré le poids de la souffrance, comment cet homme ayant traversé les mêmes épreuves se fait le seul compagnon possible. Oui, une fraternité des vivants portant les morts est possible. Elle forme l’arrière-fond de ce poème du cri et de la douleur, de l’impossible remontée vers le mensonge et la distraction. Elle supporte celui qui veut faire de sa vie un destin d’homme.
Avec L’attente de la tour, Réginald Gaillard s’inscrit dans le cercle fermé des poètes qui relancent la poésie vers de nouveaux horizons. Il ne s’agit plus d’attention, presque virgilienne au présent, à ce que nous murmurent la nature et les mystères dont elle peuple nos intérieurs. Nous voici de nouveau confrontés à nous-mêmes, au grand souffle qui nous traverse. Nous voici appelés à la confrontation, à la violence sous toutes ses formes, à la résistance, peut-être héroïque. L’humanité nous échappe. Elle nous crie de revenir à elle. Il n’est plus temps de reculer. Le meilleur de ce que nous sommes nous enjoint au réveil. Le combat commence. La victoire se fera au prix d’une vigilance et d’une lucidité qui nous dépouilleront jusqu’à nos cendres.
Pierrick de Chermont
Dernières critiques
Jean Blot, Le rêve d’une ombre
Un mot insolite résonne comme un leitmotiv dans Le rêve d’une ombre de Jean Blot, deuxième volet de la trilogie « Histoire du passé » qui, après l’Egypte, nous plonge cette fois dans la Grèce ancienne : l’anthropophanie, qui désigne l’apparition de l’homme (anthropos) à la lumière de sa propre conscience…
Corine Pelluchon, Les nourritures
Plaidoyer pour un « cogito gourmand et engendré » (Éditions du Seuil, 2015)
Dans cet essai passionnant, Corine Pelluchon tente de répondre à une question des plus simples : Pourquoi, alors que nous en voyons la nécessité, ne changeons-nous pas de vie ? Pourquoi, alors que notre mode de vie court à la catastrophe, n’en changeons-nous pas ?
Matthieu Gosztola, Nous sommes à peine écrits
Éditions numériques Recours au Poème, 2015
Attention, voici un recueil à ne pas laisser passer ! Si j’étais a priori un peu réticent par rapport au principe des éditions numériques, je suis très reconnaissant envers les éditeurs de Recours au Poème de rendre possible la publication d’un tel recueil…
