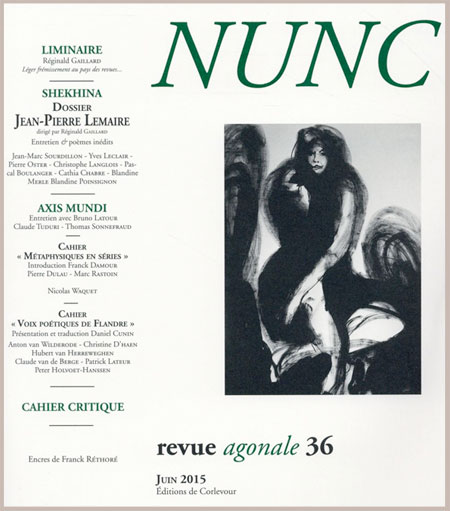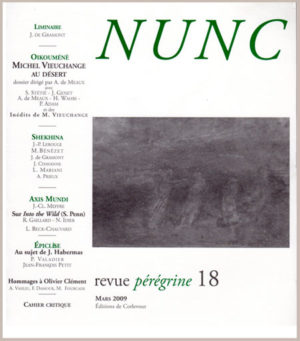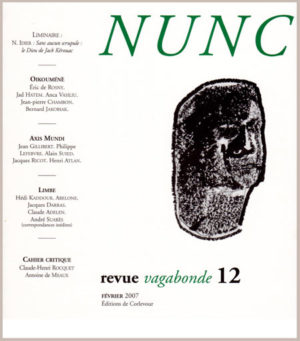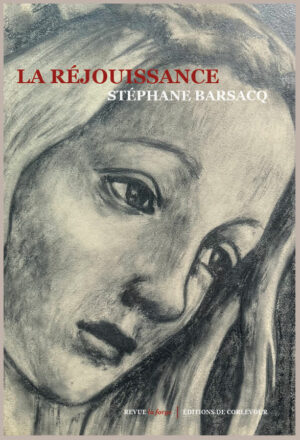LIMINAIRE
Léger frémissement au pays des revues…
Il se disait, après le succès retentissant de XXI, publication périodique qui ne fait jamais que du journalisme – certes de qualité, mais, j’insiste : du journalisme, avec une once de création –, il se disait, donc, que le temps des revues « traditionnelles » était révolu. Il semble n’en être rien au vu de l’actualité littéraire de ces derniers mois – et c’est heureux. En effet, la vieille Dame NRF prend, avec Michel Crépu à sa direction, un nouveau virage ; de même pour La Revue littéraire de Léo Scheer, où Richard Millet trouve une tribune digne de ce nom, après le lynchage médiatique et l’ostracisme qu’il a subis ; Ligne de risque, la revue de Yannick Haenel et François Meyronnis, que je considère comme l’une des revues les plus importantes de la charnière de nos deux siècles, reparaît après plusieurs années de silence ; enfin, une création, aux éditions Grasset, sous la houlette de Charles Danzig, Le Courage. Une nouvelle revue est toujours une réjouissance, car c’est certainement l’acte le plus généreux qui soit dans l’édition.
Mais qu’est-ce qu’une revue ? Un espace de rencontre – et donc d’hospitalité –, un laboratoire de pensée et de création, un ring de boxe, une piste de danse, un boudoir, une chapelle où la prière est fervente ; mais aussi : une arme de poing, un trait que l’on jette avec l’espoir d’atteindre en son cœur celui que l’on considère comme l’ennemi – le nihilisme pour Nunc et Ligne de Risque, le populisme littéraire pour Dantzig, etc.
Toutes ces revues ont en commun de faire un même constat de crise globale, donc de partir de la réalité, voire de l’actualité récente – sans pour autant se compromettre avec le politique. Mais elles en donnent, bien sûr, des lectures différentes.
Ces revues puisent aussi dans le terreau littéraire du passé, afin de nourrir leur réflexion sur la littérature. Elles tentent de la repenser, à l’aune de la période charnière qui est la nôtre.
Être ou ne pas être dans l’arène
Être en prise avec le réel
La NRF prend un nouveau départ, avec un virage à 180° par rapport à ce qu’elle était devenue ces dernières années. Renouer avec l’esprit de la NRF de Jacques Rivière et Jean Paulhan, telle est l’intention de Michel Crépu. « Nous vivons une nouvelle crise de civilisation. Cela veut dire que la revue entre en confrontation avec les grands enjeux : qu’ils soient esthétiques, littéraires, politiques, philosophiques, religieux. » Noble et louable ambition qui moque les modes pour se mesurer à l’essentiel. Il ne s’agit pas de « revenir », comme l’on dirait en politique « restaurer » ; non, il s’agit d’instaurer un mode qui fut, et de le composer au présent, au présent de narration, au présent de l’invention qui n’oublie pas ce qui fut.
Néanmoins, rien de nouveau ne brille sous le soleil : nos revues sont plus que jamais soumises à la question que posait Julien Benda dans La trahison des clercs : être au-dessus de la mêlée, ou en son cœur. Haenel et Meyronnis affirment qu’« il n’y a pas d’écriture hors-sol […], ni d’écriture hors temps. Ce qui revient à dire que celui qui se propose d’écrire se doit de répondre à cette double question, d’où j’écris et à quel moment [1] ». Il convient plus que jamais d’être en prise directe avec la réalité. Quel est le plus petit dénominateur commun de nos quatre revues ? Paraître après les attentats de janvier 2015 et la parution du roman Soumission de Houellebecq. Toutes en parlent ; impossible de faire l’impasse, sauf… Le Courage. Je ne peux croire que ce silence est involontaire ou qu’il est une forme de désinvolture : c’est un choix littéraire, une volonté de ne pas sombrer dans le populiste au sens où l’entend Dantzig [2].
Richard Millet, dans La Revue littéraire, consacre à Soumission un cahier de trois articles. Et dans la NRF, Crépu ironise : « Houellebecq, puisque tu as l’air de sentir les choses ! Parle, nom de Dieu ! Ne vois-tu pas que nous sommes perdus [3]! »
Si Houellebecq ne séduit guère par son style, sa pertinence sociologique en fait cependant un romancier incontournable. Ligne de risque partage avec l’auteur de Soumission le constat d’un « approfondissement incessant de la soumission, jusqu’à rejoindre […] une certaine apathie » ; que « la République est morte, et son soubassement, les ‘‘lumières’’, en pleine capilotade ». Mais Haenel et Meyronnis affirment prendre une voie radicalement différente : « Ce qui nous intéresse, vers quoi nous tendons, c’est le ‘‘Le Lieu de la vie’’ – où le commencement coïncide avec la fin. » Chez les chrétiens, on appelle cela l’Eucharistie d’une part, d’autre part le Christ, celui qui est l’alpha et l’oméga. Ils poursuivent ainsi : « Qu’est-ce qu’un écrivain, selon nous ? – Celui qui cherche – qui trouve – qui est émerveillé – enfin, qui règne. C’est la pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs devenue pierre d’angle. » Puis vient une référence au catholique irlandais James Joyce : « Word, save us. » Ça sent le bénitier, mais pas encore le coming out catholique.
Millet, prolongeant le propos de Houellebecq, est, à son habitude, plus radical et définitif : « […] ce qui est mort avec Paulhan, ce n’est pas seulement une ‘‘certaine idée de la littérature’’, c’est la littérature en tant qu’elle est constitutive de l’esprit et de la nation française ». Ce qui est mort avec Paulhan, « c’est la ‘‘littérature française’’ en tant qu’épiphanie post-religieuse, ce que dit Soumission n’étant rien d’autre que la fin littéraire de la France, c’est-à-dire la défaite du Christianisme [4] ». Que la littérature comme « épiphanie post-religieuse » disparaisse, on ne peut que s’en féliciter – elle était devenue un Veau d’or hérité des Romantiques. Quant à la fin littéraire de la France, quand même le statut social de l’écrivain n’est plus ce qu’il fut, que faites-vous monsieur Millet de Quignard, Bergounioux, Michon, Claude Louis-Combet, Jean Rouaud etc ; et, parmi les plus jeunes, de Laurence Plazenet, Matthieu Riboulet, Jean-Baptiste Del Amo – et la liste pourrait s’allonger – dont l’exigence de la langue est exemplaire ? Il reste des écrivains. En revanche, je vous l’accorde, il y a un divorce entre ceux-ci et la Nation – Péguy, où es-tu ?
Crépu maintenant : « […] la conscience européenne se voit offrir le miroir de sa langueur intime, si lente, si douce, si mortifère ». Quant à Dantzig, il reste sur la défensive et espère que la tempête ne détruira pas sa tour d’ivoire… : « Nous vivons le temps des esprits absolutistes dans des temps relativistes. […] Vers où allons-nous ? Une porte à deux vantaux est grande ouverte devant nous, d’où une tempête cherche à nous aspirer ».
Nunc, en 2002, dans son premier liminaire, établissait déjà un constat alarmant : « Dans quel épuisement vivons-nous ? Quel est cet à-bout-de-souffle qui nous tient lieu de vie ? Rarement les horizons auront été aussi impossibles, pas de quoi joindre la mer et l’éternité. La quête d’Ulysse se serait-elle égarée, vidée, abandonnée ? Pourquoi tant de procurations, de substitutions, de prothèses ? » (F. Damour). Nunc pointe par ailleurs, depuis douze ans, le raidissement idéologique et religieux qui n’a cessé de s’accentuer. La ligne de crête que tient Nunc est de plus en plus périlleuse ; son équilibre, instable – mais il convient de tenir la position, fût-elle instable.
Que dire des pages de Beigbeder, qui nous livre, dans la NRF, ses « réflexions » de l’après-Charlie ?… J’observe tout de même qu’il émet l’hypothèse d’avoir, par son comportement, « peut-être contribué à dégoûter la jeunesse de (son) pays ». Malheureusement, au lieu d’un sursaut, en guise de réponse aux bruits des armes, il préfère plus que jamais la fête : « Je veux juste écrire, boire du bon vin et baiser » ; « Ce sera mon djihad à moi durant le restant de mes jours. Résister aux forces de l’anti-fête. […] j’attends, ma coupe de champagne à la main, que les suicides cessent, pour entendre de nouveau la musique [5] »…
Nous lui signalons juste, au passage, qu’il n’est pas plus facile d’avoir la foi que d’être athée. Quid du doute qui nous taraude ? De la responsabilité à laquelle cette foi nous oblige – au sens où le croyant est l’obligé de… ? Flannery O’Connor nous le rappelle : « La plupart des gens ne mesure pas le prix que vous coûte la religion. Ils considèrent la foi comme une couverture électrique, alors qu’elle signifie, évidemment, la croix. Il est beaucoup plus dur de croire que de ne pas croire [6]. »
Le constat est général d’une fracture épistémologique radicale, autant technologique que politique et spirituelle. Mais ce n’est pas tout : la rupture en cours est aussi sociologique.
L’hospitalité à voilure variable
La confrontation à la réalité, aujourd’hui, passe par la confrontation à l’autre, à la différence. La question sous-jacente de Soumission, sans la nommer, est celle des mouvements de population qui bouleversent de fond en comble les sociétés occidentales. Peur naturelle de disparaître, pas seulement à titre individuel, mais aussi collectif : crainte de voir disparaître notre civilisation – confer Paul Valéry : « Nous civilisations… » Certes… Mais qu’en reste-t-il à ce jour ? Qu’est-elle devenue… ? Elle est en pleine mutation. Qu’importe à vrai dire qu’elle disparaisse, qu’importe le cadre, car nous ne nous soucions que du témoignage hérité de nos pères, celui d’un homme, le Fils de l’homme, venu pour tous, les Grecs, les Juifs, les païens… Il s’agit donc d’accueillir, d’être hospitalier – ce qui ne signifie pas se renier. Sur cette question il convient aussi de citer Frédéric Boyer qui affirme dans son dernier essai qu’« on ne bâtit pas une civilisation sur le thème hallucinatoire de l’invasion et du remplacement. [Qu’]on ne fonde pas une communauté sur la suspicion d’autrui. Et la simple idée qu’une identité forte et assumée, bien distincte, serait la mieux à même de nous permettre l’accueil, c’est alors supprimer le risque, l’ébranlement, l’inquiétude sans lesquels nulle éthique ne se découvre [7] ».
Néanmoins, l’hospitalité, pour être vraiment, ne peut être que radicale et sans conditions, afin de ne pas rester un vœu pieux. Elle est l’exigence spirituelle même ; elle est notre défi. Soyons sûr que là où se manifeste la fraternité, le Royaume est en chantier. Mais cela implique, du côté de celui qui accueille, comme de celui qui est accueilli, que plus aucune référence ne soit faite à la nation – ni même à la patrie –, à la frontière, non plus, par conséquent, qu’à la langue, à la culture, au religieux. Qui est disposé à cet abandon ? À mon sens, personne. Ce serait se nier les uns les autres. Cela ne voudrait-il pas dire qu’il n’y a plus que des hommes qui se rencontrent, face à face, face à Dieu – face à Lui et non sous son regard – car Dieu n’est pas au-dessus de nous et nous ne lui sommes pas soumis, puisque libres ? Méditons saint Paul qui nous rappelle à l’essentiel : « Que ceux qui usent de ce monde soient comme s’ils n’en usaient pas, car la figure de ce monde passe. » (1 Co 7,30)
Le religieux comme ligne de fracture
À Saint-Germain, on n’est pas chrétien ! Ce pourrait être le slogan de la revue Le Courage, car, apparemment, pour Dantzig, avoir la foi ne semble guère compatible avec l’intelligence. Il affirme sans ambages qu’avec la Renaissance, les « élites commençaient à se libérer de la glu noire de la Foi »… Et je passe sur l’erreur de méthodologie historique de faire de la Rome chrétienne du Moyen Âge un « régime d’une brutalité vulgaire, proto-fasciste ». Anti-christianisme bon teint et si banal d’une partie de la gent littéraire française.
Dans la NRF, Michel Crépu s’interroge sur ce que sont devenues les Lumières de l’islam. Elles existent pourtant bel et bien, cependant les media ne les évoquent pas – pas assez sensationnel et cela requerrait une analyse et des nuances qui ne sont pas le propre du journalisme de masse. Qui a lu Gamâl al Banna [8], ou encore Les nouveaux penseurs de l’islam auxquels Rachid Benzine [9] nous a pourtant sensibilisé ? C’est sur eux qu’il conviendrait de mettre l’accent, plutôt que sur le trop ambiguë Tariq Ramadan.
Que faire face à tant de méprise, de méconnaissance ? Maintenir haute l’exigence spirituelle – donc humaine, donc politique – de notre vie commune sur une terre étroite et en maints endroits ingrate ou hostile. Ligne de risque l’a déjà fait, en livrant des études sur le judaïsme, mais aussi le shiisme (cf l’entretien avec Christian Jambet dans un numéro de l’ancienne série et aussi celui de Nunc). Par ailleurs, Nunc publiera en 2016 un dossier consacré aux cultures d’islam.
Préserver des îlots de résistance face à la barbarie qui vient. Paranoïa ? Je la préfère à la naïveté.
Préparer l’héritage, comme le firent les monastères au Haut Moyen-Âge, et transmettre à ceux qui peuvent, qui veulent encore hériter. Peu de chance que ce soit nous qui inventions le nouveau cadre nécessaire, mais plutôt nos enfants.
Forger notre langue et notre culture au feu du passé, non pour fuir le présent et ne pas affronter le futur (d’ailleurs le futur ne s’affronte pas puisqu’il n’existe pas encore : il se rêve et s’invente – « J’aime celui qui rêve l’impossible », disait Goethe), mais parce qu’on ne crée pas sans racines, sans contrepoint avec la tradition. La création ex nihilo est un leurre, une impasse.
L’ombre du passé
Revisiter les ruines oubliées du passé ; relire les Anciens. Crépu le rappelle : « La revue, en publiant des textes puisant aussi bien au patrimoine des ‘‘anciens’’ qu’au vivier de la création contemporaine, entend faire valoir un sens de la continuité à travers les siècles. » Ce n’est qu’ainsi que l’on inventera l’avenir. La Renaissance n’a-t-elle pas puisé aux sources de l’Antiquité ?
Dans Ligne de risque, Sollers l’ultramontain évoque Joseph de Maistre : « Avec lui, on prend comme point de départ ce constat, dans Considérations sur la France : la Révolution française est satanique. Là-dessus, l’Université, c’est-à-dire tout le monde, ne peut que mollir. Voilà bien ce qu’elle n’a aucune envie d’entendre. » Prenez garde, monsieur Sollers, les chiens de garde de la République des Lettres vont vous passer, en guise de garrot, la sainte pétition purgative autour du cou – mais il est vrai qu’à une statue, cela ne fera guère de mal, et ne laissera pas la moindre trace. Privilège de la réussite consolidée – et de l’âge.
Sollers encore : « Joseph de Maistre est la Révolution elle-même. C’est même pourquoi, n’en déplaise à tous les clergés progressistes, il est le seul à la penser dans toute son ampleur. Ce qui signifie : dans son rapport avec le mal. » Malheureusement rien d’étonnant ici : le mal est une question théologique. La théologie n’est pas morte, mais ses questions ont déserté le champ littéraire – à quelques exceptions près bien sûr, dont Richard Millet. On s’en rendra compte le jour où on le lira un peu sérieusement [10]. Je regrette cependant que Sollers n’approfondisse pas davantage cette remarque : « Il y a un problème avec le catholicisme français, on en souffre tous les jours. Ça manque d’Italie. » Ou celle-ci encore : « … la vraie question, c’est le péché originel. Qui, aujourd’hui, y accorde de l’importance ? »
De son côté, Haenel affirme que, dans Ligne de Risque, « nous n’aspirons qu’à parler dans l’intégrité de notre parole, donc à désépuiser le langage. Ce qui va de pair avec une attention portée à notre manière de vivre, aux formes de vie que nous choisissons ; et avec le souci de nous rassembler dans l’écoute de toutes les paroles vivantes du passé. ‘‘Nous autres, catholiques errants’’, pour reprendre un mot célèbre de Joyce [11] ». Signalons que Ligne de risque revisite dans la première livraison de sa nouvelle série le grand roman à pas aveugles de par le monde de Leïb Rochman auquel elle consacre un dossier.
La NRF, elle, revisite l’un des sommets de la littérature espagnole du XXe siècle, Miguel de Unamuno, auteur d’un essai majeur qu’il serait urgent de rééditer : Le Sentiment tragique de la vie [12]. « Le Mal du siècle », traduit ici par Yves Roullière, est un texte antérieur qui peut être considéré comme la matrice de cet essai. Dans le projet de la nouvelle NRF, il fait figure d’état des lieux spirituel, auquel nous souscrivons totalement : « … il est peu de crépuscules aussi tristes que celui de notre siècle, où une grande fatigue, la fatigue du rationalisme, plonge les esprits cultivés, désorientés, dans la tristesse de leur propre culture. En tous lieux on trouve des symptômes de décompositions spirituelles et des ruines d’idées soit mortes, soit avortées. » Plus actuel encore : « Une apparente atonie recouvre une vive ébullition intime ». ébullition de Ligne de risque, de la nouvelle NRF, mais aussi de Conférence, de Fario pour ne citer que quelques-unes des revues actuelles les plus importantes.
Quand tout se délite, tout devient promesse.
Repenser la littérature
Les revues restent des lieux de réflexion pour la littérature – idée classique de laboratoire. Pour Courage, l’ambition est de participer à la création et à la réflexion de la littérature « en train de se faire ». Quelle déception, néanmoins, que cette première livraison de Courage… C’est une Babel dénuée de sens, si ce n’est celui du cosmopolitisme. Si vous ne parlez pas quatre langues [13] – les plus communes d’Europe – passez votre chemin. Dantzig nous rappelle que Un coup de dé n’abolira jamais le hasard a été publié par la revue Cosmopolis, où toutes les langues se côtoyaient. Certes, mais c’était une revue franco-américaine. Cela pose, quoi qu’il en soit, une intention d’élitisme revendiqué (pour ne pas dire dandysme germanopratin à prétention élitiste). Accéder, pour un usage courant, à l’anglais, l’allemand ou l’espagnol, rien là de très original, mais s’emparer, dans ces langues, de textes dits littéraires, c’est tout autre chose. Certes, on peut qualifier Nunc d’« élitiste » ; cependant, ce qui vient des autres langues, nous le faisons traduire. Cosmopolitisme, World litterature, comme un dérivé de la World music. Parce que ce qui est « national » est forcément suspect, sans parler du régional, nécessairement fascisant… Il faudrait être sans frontière, citoyen du monde… Ce qui, au passage, supprimerait la question de l’hospitalité, puisqu’il n’y aurait plus de différence… Le même n’a pas à s’accueillir. Pour ma part, je ne conçois d’accueillir l’autre que parce que je sais qui je suis et d’où je suis. C’est ce qui diffère de moi que j’accueille, ce à quoi je suis attentif, non sans ébranlement et inquiétude intérieurs, mais dans la certitude de ce que je suis.
Ces revues abordent aussi la question cruciale de ce que doit être la littérature. Dantzig, dans son texte « Une porte s’est ouverte », revient sur la querelle [14] qui l’oppose à Michel Crépu à propos du populisme en littérature, qui, d’après lui, Dantzig, flatterait les bas instincts, susciterait la violence et le voyeurisme. à vrai dire, ce n’est pas la littérature en elle-même qui recèle ces travers, mais l’homme, mi-bête mi-ange. N’est-ce pas une des fonctions de la littérature que de sonder les affres monstrueuses de notre nature ? Quelle autre fonction pour la littérature ? Dantzig est en fait encore attaché à cette vieille rengaine héritée d’une conception autotélique de la littérature, chère aux structuralistes sauce barthienne : « La littérature naît de la littérature. Son objet est la littérature. Pas la morale, pas le cœur humain, rien de ces intérêts pratiques. Il n’y a pas d’autre objet sérieux à la littérature que la littérature [15]. » Comme je regrette que l’on n’évoque jamais, ou si peu, le dernier Barthes, celui qui rêvait de devenir romancier…
Quant au programme littéraire de Michel Crépu, il prend racine dans une citation de Sollers : « Le raz de marée de liberté du XVIIIe siècle a engendré Sade ; le XIXe siècle a travaillé à l’ignorer ou à le censurer ; le XXe s’est chargé de le démontrer, de façon hurlante, par la négative ; le XXIe siècle devra le considérer dans son évidence. […] cela ou la résignation au mensonge de l’insignifiance. » Crépu poursuit : « Nous y sommes. La littérature du XXIe siècle qui démarre est attendue sur ce terrain-là, il n’y en aura pas d’autre. » Renouer avec la grâce, nous dit Crépu, car « quand il y a la grâce, cela veut dire que le plus profond, le plus précieux, le plus simple ne pèsent pas et qu’ils sont bien là, pourtant. » Enfin, il renvoie dos à dos antimodernes et modernes, car selon lui « le temps de l’après-Monde commence, il reste à l’écrire ».
Mais nous sommes hanté par l’absolu littéraire ; c’est l’héritage, lourd à porter, des Romantiques allemands. Cependant Novalis et Schlegel étaient encore chrétiens. Ils préservaient une verticalité qui a déserté la pensée contemporaine – du moins la plus en vue –, et n’accordaient certainement pas autant de crédit au potentiel de la littérature que le font aujourd’hui la plupart des écrivains – ou, si les Romantiques le faisaient, c’était encore à la grâce de… C’est la laïcisation de cet absolu qui l’a rendu funeste et a fait de la littérature une idole. L’erreur fondamentale est de croire qu’elle est une possible planche de salut, alors qu’elle n’est qu’un besoin irrépressible de dire le monde, de le chanter, en des formes sans cesse réinventées, rigoureuses – et belles.
Euphorie du commencement ; sentiment de puissance… Comment re-commencer ? Entre autres en poursuivant le travail inauguré par Artpress qui, dans un éditorial, en 1982, écrivait : « Dans l’enseignement de la philosophie tel qu’il se pratique dans nos lycées, tout se passe comme si l’histoire de la pensée s’arrêtait à Platon pour ne recommencer qu’avec Descartes. Entre temps le vide […] à y réfléchir, nous nous trouvons là face à l’un des plus considérables refoulements qu’on puisse imaginer […] Saint Augustin, Albert le Grand, saint Thomas, saint Bonaventure, Duns Scot sont-ils donc à ce point des penseurs négligeables [16] ? »
C’est ce refoulement qu’il faut revisiter, réinvestir.
Fragments de pierre en guise d’épilogue
L’objet de la littérature n’est pas la littérature elle-même – autotélisme [17] narcissique – ni une sèche et brutale description du réel –, mais l’épreuve spirituelle du sensible, et de la vie, dans son mystère radical. C’est de cette épreuve que naît une forme personnelle et universelle.
*
Il faut avoir une intelligence grammaticale du monde pour participer à sa création – vision de l’homme co-créateur.
*
Le roman est le lieu de convocation du réel – mais il dit bien davantage que ce réel. Il voit à travers, et donc au-delà. Il doit dire l’au-delà de ce qui est vu.
*
Il n’est d’écriture que christique, c’est-à-dire animée par une double nature : le verbe et la chair – son incarnation.
*
Fonction du roman : embrasser le temps long – fût-il celui d’une journée sans fin comme dans l’Ulysse – : les lentes lames de fond disent autre chose que l’écume éphémère et futile.
*
Fonction de la littérature : mettre à nu le sentiment tragique de nos vies.
*
Fonction de la littérature : dans un même élan ébranler la raison et émouvoir le cœur, qui n’aspire qu’à s’élever.
*
Fonction de la littérature : capter l’ombre et la lumière. Celles des corps ; celles de la plaine comme celles de la ville ; celles de nos âmes torturées.
*
Le poème : acte par excellence de résistance spirituelle au délitement – esthétique, grammatical, moral et, a fortiori, politique. Dès lors, oui : « les raisons poétiques sont les plus exactes » (Dantzig).
*
Écrire, inscrire l’homme dans l’épaisse nuit du temps. L’épreuve du temps, machine à broyer, constitue notre tragédie.
L’écriture, comme la musique, est une façon d’éprouver le temps. D’en prendre la mesure.
*
Ce que nous voulons : l’homme. Non pas l’Homme, non, pas une idée, idéaliste, irréaliste, source d’idéologies meurtrières, mais l’homme dans toute sa complexité et son mystère. C’est pour cela que Nunc dit l’homme poétiquement, philosophiquement, théologiquement ; que Nunc l’approche par l’image, qui n’est jamais qu’un reflet, mais qui dévoile son intériorité.
*
Comment recommencer autrement ?
Réginald Gaillar
——————————————————–
[1] Yannick Haenel & François Meyronnis, « Éditorial », Ligne de Risque, p. 5-9.
[2] Ne pas voir là un reproche de notre part : Nunc, en février dernier, n’a pas non plus évoqué les attentats de Paris.
[3] NRF n° 612, avril 2015, Michel Crépu, « Du monstre », p. 7.
[4] Richard Millet, « Le salut par l’islam », La Revue littéraire, p. 2.
[5] Frédéric Beigbeder, « Hé bien ! La guerre », NRF, n°612, p. 25 et 26.
[6] Flannery O’Connor, Lettre à Louise Abbot, 1959, Œuvres, Gallimard, coll. Quarto, 2009, p. 1108. Cité par Yves Leclair, dans ce même numéro de Nunc.
[7] Frédéric Boyer, Quelle terreur en nous ne veut pas finir, POL, 2015, p. 18. Nous débattrons de ce livre dans le n°37 de Nunc.
[8] Gamâl Al-Banna, L’Islam, la liberté, la laïcité, ouvrage présenté et traduit par Dominique Avon, Amin Elias, avec la collaboration d’Abdellatif Idrissi, L’Harmattan, 2013, 194 p.
[9] Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Paris, Albin Michel, coll. « L’islam des Lumières », 2004, 288 p.
[10] Signalons au passage la grande beauté des fragments de son journal (1970-75), publiés dans La Revue littéraire. C’est là la matrice de son œuvre. Toutefois, je ne peux m’empêcher de croire que certains passages sont très récents… comme si Richard Millet souhaitait réécrire son propre parcours (Ne dit-il pas que ce journal est une œuvre littéraire ? C’est presque un avis) et ainsi procéder à une mythobiographie. D’ailleurs, à ce sujet, il conviendra plus tard de vérifier si Millet est réellement aller se battre au Liban. à ce jour, nous n’avons que sa parole, une parole de pur écrivain, rompu à l’usage du mentir-vrai au service de l’écriture.
[11] Haenel et Meyronnis, « Éditorial », dans Ligne de Risque, p. 7.
[12] Miguel de Unamuno, Le Sentiment tragique de la vie, Gallimard, 1917, trad. de l’espagnol par Marcel Faure-Beaulieu : rééd Folio 1997 – épuisé.
[13] Remercions Dantzig de tolérer que nous ne lisions pas le Chinois : le texte de la dissidente Chun Sue a été traduit par N. Idier.
[14] Charles Dantzig, « Du populisme en littérature », Le Monde, 17 mars 2012, article auquel répond Michel Crépu : « Le puritanisme, vrai ennemi de la littérature », Le Monde, 04 avril 2012. Articles en ligne sur le site du Monde. D’ailleurs, il n’est pas impossible que l’idée du titre Le Courage soit venu à Dantzig à la lecture de l’article de Michel Crépu qui citait Simon Leys en ouverture de sa réplique : « Les artistes qui se contentent de développer leurs dons n’arrivent finalement pas à grand-chose. Ceux qui laissent des traces sont ceux qui ont la force et le courage d’explorer et d’exploiter leurs carences. »
[15] Charles Dantzig, « Une porte s’est ouverte », dans Le Courage, n°1, p. 46.
[16] Cité par Pascal Boulanger dans Jacques Henric, Faire la vie, entretien avec Pascal Boulanger, éditions Corlevour, 2013.
[17] Jean Rouaud, Misère du roman (Grasset, 2015) constitue un véritable enterrement de Barthes.
DOSSIER
Dossier consacré à : LEMAIRE Jean-Pierre
« Le Chant du monde de Jean-Pierre Lemaire »
Après Jean-Claude Renard, Pierre Emmanuel, Jean Grosjean et G. M. Hopkins, Nunc poursuit son exploration des voix poétiques qui puisent aux sources de la foi chrétienne. Voici maintenant Jean-Pierre Lemaire. C’est dans la discrétion qu’il construit son œuvre poétique, pourtant publiée pour l’essentiel chez Gallimard. C’est peut-être en raison de cette discrétion, qu’à ce jour, peu de revues lui ont consacré ne serait-ce qu’un cahier d’études, à l’exception notable, en 2004, de Tra-Jectoire, éphémère revue dirigée par le brillant Amaury Nauroy. Mais il est vrai qu’à cette période – depuis 2002 –, J.-P. Lemaire traversait, « sans la musique », une période de mutisme – le chant s’était éteint. Il était « Zacharie », sans voix pour chanter, et cela dura jusqu’à la parution en 2008 de Figure humaine. Cette période douloureuse de silence n’aura pas aidé à attirer l’attention sur lui. Depuis, fort heureusement, le Prix Alain Bosquet est venu couronner une voix que nous tenons pour majeure.
J.-P. Lemaire ne nous a pas seulement ouvert les portes de sa maison, il s’est aussi livré, évoquant son enfance, sa vie « silencieuse » à l’écart et, enfin, il nous a dévoilé son atelier poétique. Comme il nous l’a confié, il n’y aurait pas eu de poésie en lui s’il n’y avait eu une conversion au réel, c’est-à-dire, pour lui, une conversion véritable au christianisme. Ayant compris qu’il ne deviendrait pas musicien, c’est vers la poésie qu’il a essayé de retrouver le chant : « Je me suis aperçu, nous dit-il, que les mots n’étaient pas seulement des éléments esthétiques comme pouvaient l’être les notes, mais qu’ils étaient lestés du poids du monde, du poids des êtres. Et c’est ce poids que la poésie peut prendre en charge afin d’en faire un chant. »
Ses premières publications (Les Marges du jour, La Dogana, 1981 – dont Blandine Poinsignon nous offre ici une lecture –, et L’Exode et la nuée, Gallimard, 1982) viennent après dix années de travail souterrain. Il est vrai, comme le rappelle Pascal Boulanger, que les années 70 ne furent guère favorables à une telle poésie ; et d’ailleurs, la voix naissante de Lemaire ne fut pas sans susciter quelques sarcasmes… Ce furent des années de plomb, comme aime à le rappeler Pierre Oster. Mais pour certains, dont Pascal Boulanger, cette voix naissante fut « un appel d’air dans lequel la dilatation et l’approfondissement reprenaient l’initiative ». C’est aussi en raison de ce contexte que le lyrisme de Lemaire est tout en retenue, comme un chant en sourdine.
Ainsi que Lemaire l’avoue dans l’entretien, l’origine du poème reste pour lui mystérieuse. L’expérience poétique implique un « retrait qui permet à plus grand que soi de se manifester ». Et ce plus grand se manifeste, humblement, dans les détails infimes du quotidien des êtres et des objets, dans leur précarité, leur fragilité, détails auxquels il faut être attentif pour les accueillir pleinement dans la langue.
L’un des traits qui revient souvent chez ceux qui évoquent notre poète et sa poésie est son humilité. Toutefois, comme le souligne ici J.-M. Sourdillon, « celle-ci ne se trouve pas dans la recherche tendue d’une posture excessive d’abaissement, de négation de soi, voire d’humiliation (…) mais tout au contraire dans une manière de s’ouvrir, de se rendre disponible en aimant ». La poésie de Lemaire est aussi qualifiée de quotidienne : Blandine Merle nous montre combien il « fonde sa poétique non sur l’imperfection reconnue comme cime, mais sur l’assurance que la vie se donne sous nos yeux », et Sourdillon ajoute que Lemaire dit « les choses les plus simples de la vie ordinaire, mais baignant dans une lumière qui, elle, n’a rien d’ordinaire » – importance par ailleurs de la lumière du soleil qui, au moment de l’aurore, dévoile une à une les choses appelées à être nommées.
L’écriture de Lemaire puise bien sûr aux sources de la Bible, mais les figures mythologiques n’en sont pas absentes pour peu qu’elles soient à même de dire la nature du poète : l’incontournable Orphée, ainsi qu’Icare, évoqué ici par Yves Leclair. Christophe Langlois, pour qui lire Lemaire est un « renouvellement du regard », évoque un « manque central, une fragilité dans son œuvre qui l’élève à l’universalité ». Jean-Marc Sourdillon revient quant à lui sur l’importance de la « rencontre » de Lemaire avec sainte Bernadette Soubirou, qui lui fit don de larmes salvatrices. Il évoque minutieusement ce petit livre, le seul en prose, où Lemaire « en dix stations » tente de déchiffrer « le sens énigmatique de ces larmes comme si elles étaient un signe, un poème… » Yves Leclair, dans une épître au rythme épique, aussi flamboyante qu’érudite, aboutit – entre autres – à la conclusion que « la poésie sans ailes, dans sa mémoire de la mort et de la chute, devient aujourd’hui, avec la vôtre, cher Jean-Pierre Lemaire, un art de la Résurrection. »
Pierre Oster, qui retrace en quelques notes la relation éditoriale amicale et poétique qu’il a entretenu avec lui, l’évoque, aux côtés de Philippe Delaveau, comme un surgeon de cette souche de la poésie chrétienne. Il dresse l’arbre généalogique du poète et en fait un héritier de Claudel, Patrice de la Tour du Pin, Jean-Claude Renard, Jean Cayrol et Jean Grosjean. Néanmoins, mis à part Claudel, c’est pour l’essentiel auprès des poètes étrangers qu’il a forgé son verbe poétique, notamment Boris Pasternak.
L’essentiel, ce dont nous devons vivement remercier Jean-Pierre Lemaire, c’est que sa poésie contribue, et je reprends là les mots d’Yves Leclair, à « réveiller le chœur des poètes devenus les gardiens endormis du tombeau vide de la poésie et de notre ici-bas ».