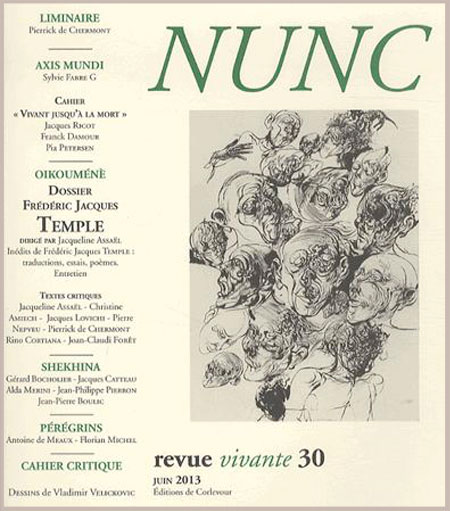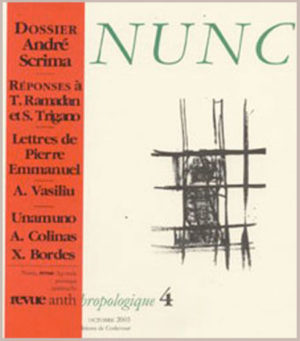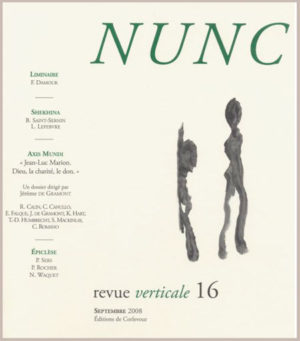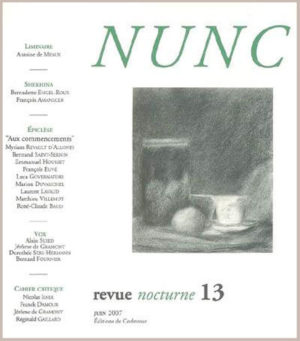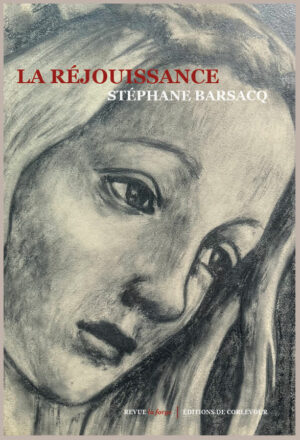SOMMAIRE
LIMINAIRE
Pierrick de Chermont Le Courage d’Être
AXIS MUNDI
Sylvie Fabre G., Poèmes
CAHIER « Vivant jusqu’à la mort »
Franck Damour Introduction
Jacques Ricot La fraternité accomplie: éthique des soins palliatifs
Pia Petersen Testament de vie
DOSSIER : « Frédéric Jacques Jacques : la poésie des sept points cardinaux »
sous la direction de Jacqueline Assaël
Jacqueline Assaël Introduction
Frédéric Jacques Temple
Frédéric Jacques Temple Henri Pichette ou l’enfance des mots
Rino Cortiana LYNX LYNX (extraits) trad. de F J Temple
Frédéric Jacques Temple Entretien avec Jacqueline Assaël
Jacques Lovichi L’Inaudible me régénère
Pierre Nepveu Frédéric Jacques Temple et les voix d’Amérique
Christine Amiech Profonds Pays : au coeur du lyrisme de F J Temple
Jacqueline Assaël Le Dieu de l’enfance, dans l’oeuvre de F J Temple
Pierrick de Chermont F J Temple: « Tel un veilleur guettant l’aurore »
Joan-Claudi Forêt Per FJT / Pour FJT
SHEKHINA
Gérard Bocholier Psaumes
Jacques Catteau Naissance et fortune du mythe littŽraire d’Oblomov
Alda Merini La Terra santa (extraits) traduction de Patricia Dao
Nunc L’imagination, puissance éthique : entretien avec J-P Pierron
Jean-Pierre Boulic Il y a une cime…
PEREGRINS
Antoine de Meaux Carnet de l’oiseleur
Florian Michel Messe dans le Far North West canadien
CAHIER CRITIQUE
A. Arjakovsky, C. Pelluchon, M. Blanchot et P. Madaule, R. Brague, Rachel
LIMINAIRE
Pierrick de Chermont, Le Courage d’être.
« Il y a-t-il quelques raisons d’espérer ? » J’entends une voix sortir d’un divan capitonné tandis que la muraille est tombée et que dans une lueur crépusculaire, des hordes remontent les rues et partent à l’assaut du palais. « Il y a-t-il quelques raisons d’espérer ? » Dans cette formule, on entend une lassitude désabusée qui brandit ses dernières forces pour un ultime geste d’élégance hautaine. Que le monde s’achève et que nous puissions retourner dans cette béance noire qui nous appelle et nous a déjà vaincu, conclue-t-elle.
Pourtant, passé la satisfaction d’avoir tenu un temps ce personnage aussi assuré que vide, notre insatisfaction reste entière. Le temps se prolonge. La fin n’est toujours pas là. Notre voix intérieure reprend alors sa mélopée douloureuse. D’où viennent ces spectres, nous dit-elle, qui nous entourent et restreignent notre champ de vie ? Quelles sont ces craintes qui nous écrasent et nous immobilisent ? Nous traversons les jours comme Marlow remontant le fleuve, « un cours d’eau vide, un grand silence, une forêt impénétrable. » Les arbres ont disparu, on n’entend plus leurs branches se gonfler et bruire dans le vent. La mer elle aussi s’est figée. Sous nos yeux, ne restent que nos paysages intérieurs et comme Marlow, on se murmure : « cette immobilité de la vie ne ressemble nullement à une paix. C’est l’immobilité d’une force implacable appesantie sur une intention inscrutable. »
Dans les meilleurs moments de lucidité, nous hésitons à croire en cette douleur sans motif qui nous oppresse. Nous cherchons à reprendre le cours de notre vie. Bon sang, il doit être possible de rejoindre les chants de l’enfance, de biberonner encore les jours et leurs sucs nourriciers. Quelques pas de danses, un instant les trilles d’un oiseau ont pu se laisser entendre et puis, rien. Avons-nous seulement halluciné ? L’obscur qui nous fixe a déjà éteint la lueur qu’on avait cru jaillir. Sommes nés trop vieux ? Sommes-nous la trop vieille Europe ?
De quels côtés nous nous tournons, nous retrouvons les mêmes yeux qui nous fixent, ces yeux qui sont les nôtres transis d’angoisse. Nous n’aurions donc plus le choix : il nous faudrait affronter cet au-delà de nos craintes et de nos peurs, cette angoisse sans objet, sans limite qui les abreuve et les fortifie. Elle serait la cause de notre désarroi, elle minerait et viendrait ronger la moindre de nos intentions. Elle est souveraine, n’est-ce pas, car elle est sans cause et elle s’avance jusqu’à poser son doigt froid sur nos lèvres. Elle est le néant qui nous fait face, non pas seulement l’inconnu, mais ce qui ne peut se laisser dévoiler car il est sans voile. Elle est le non-être, non pas la mort mais l’au-delà de la mort, la nuit primordiale du néant qui nous fait face et interdit toute projection. Elle est ce qui a toujours logé au fond de nous, qui remonte sans fin à la surface de notre conscience et y vient verser ses notes vides qui nous glacent d’horreur. Nous sommes, peuples européens, comme un seul peuple de mystiques soudain saisis de la grande « nuit de l’esprit ». Et nous luttons, et nous nous débattons. Nous inventons des craintes pour fixer cette angoisse plus grande que nous. Nous n’ignorons pas que vaines sont ces entreprises. Car cette angoisse nue est à jamais nôtre. Elle est l’existence elle-même.
À la fixer dans les ténèbres, nous nous surprenons à découvrir une familiarité avec elle. Notre sang, notre âme qui est ce lieu où sont rassemblés notre raison et notre désir, et qui porte la longue histoire informulée de notre humanité, la connaissent mieux que notre conscience moderne encore si neuve et si fragile. Ils lui prêtent trois visages ou plutôt la considèrent comme trois fleuves qui se rejoignent : l’angoisse de la mort, l’angoisse de la culpabilité, l’angoisse de l’absurde. Pas une vie d’homme ne peut être vécue sans être portée par ces trois fleuves. Qu’importe le point d’origine, vient toujours trop vite le delta où les trois fleuves se rassemblent pour n’en former qu’un ; et si chaque existence lui prête une dominante, c’est la même eau qui porte et pénètre le bateau ivre de nos vies, où « La mer dont le sanglot faisait mon roulis doux / Montait vers moi ses fleurs d’ombre aux ventouses jaunes » nous rend le naufrage impatient.
Pas une « immortalité de l’âme » ne viendra faire oublier l’extinction de soi qui est notre seul horizon. La mort, nul ne nous l’ôtera. Déjà son règne nous fait courber nos espoirs les plus vifs. Nous lui appartenons, comme nous appartenons à la contingence qui nous expulsera de l’existence suivant l’impénétrable obscurité de notre destin.
Pas un « juge miséricordieux » ne viendra éteindre la conscience de notre aliénation qui nous fait accomplir ce que nous ne voulons pas et désespérer de ce que nous sommes. On peut s’extirper de toute morale, accuser notre contingence pour effacer notre responsabilité, se désigner victime pour se pardonner d’avoir été bourreau, reste que les oripeaux qui nous couvrent cachent mal le sentiment de damnation qui nous habite : être condamnés à être celui que nous ne sommes pas.
Pas une « préoccupation ultime » ne résistera aux eaux vides et absurdes dans lesquelles nous baignons. Pas une de nos réponses à la signification de notre existence, pas une de nos créations ne résistera à la première vague qui s’avance ; tous nos dévouements s’effaceront, nos châteaux éphémères sur la rive déjà s’éboulent et fondent, tandis que la nuit gagne et avance l’abîme où se noie notre finitude. On peut « s’évader de sa liberté », se prêter à toutes les idoles, pas une n’éteindra cette séparation profonde avec cet autre soi que nous sommes et auquel nous ne pouvons qu’aspirer sans jamais le rejoindre.
« Y a-t-il quelques raisons d’espérer ? » Non, bien sûr. Rien ne viendra repousser le néant. L’angoisse qui nous étreint, n’a rien de passagère. Elle nous définit si profondément qu’il nous reste que le cri pour s’éprouver. Et pas un cri ne sort. Seul le silence règne. Et le silence qui suit est plus fin que le silence.
« Le courage d’être ». La voix intérieure que nous sommes aussi, redit ces mots pleins de mystère : « le courage d’être ». A baigner dans ces eaux noires, tous les hommes l’ont été, le sont et le seront. Pour être, il leur a fallu être en dépit de, du néant, de la faute et du non-sens. À cette puissance d’être qui nous éprouve en même temps que l’angoisse nous étreint, nous avons encore soif de répondre par l’affirmation de soi. Cette force d’âme invaincue qui nous rassemble et nous unifie, nous élance et nous ouvre, reste entière et réclame qu’on la rejoigne par tout ce que nous sommes. Par elle, nous trouverons la tempérance dans la relation avec soi-même et la justice à l’égard des autres. Ici, elle nous ouvrira les portes de la contemplation et de la sagesse, là, l’esprit de solidarité et d’entreprise. Par elle, nous trouvons la force d’être soi et la force de participer au monde.
Déjà j’entends d’autres hommes et femme sur ce chemin d’humanité. J’entends Walt Whitman m’interpeler : « ‘Allons’, qui que tu sois, viens voyager avec moi ! / En voyageant avec moi tu trouveras ce qui jamais ne fatigue. » J’entends Nadejda Mandelstam apprendre par choeur des poèmes d’Ossip pour me les transmettre. Oui, redit Paul Tillich, nous n’abandonnerons pas notre préoccupation ultime qui nous fonde et jette une lumière neuve sur nos entreprises qu’elles soient spirituelles, artistiques, scientifiques, sociales ou politiques. Et voici que je me réveille à mon tour ; voici que je cherche à nouveau les pas du berger qui fixait jadis Pierre dans la nuit de son néant.
Nous n’en avons pas fini d’être homme. Nous ne lâcherons rien de ce que nous sommes. Nous garderons vivace ce que nous appelons la foi qui n’est rien d’autre qu’un chemin de découverte et de vérité de ce que nous sommes. La marche est ce qui sied le mieux à nos muscles et à notre esprit, fusse au coeur de l’obscurité. Ensemble et seul, nous révèlerons en nous le courage tel qu’il nous change : en joie. En joie d’être.
NOTES :
1. Titre du livre de Paul Tillich, Le courage d’être, traduction par Fernand Chapey, Casterman, Paris, 1967. La lecture de ce livre est la source d’inspiration de ce texte.
2. Conrad, Au coeur des ténèbres, traduction par Jean-Jacques Mayoux, Flammarion, GF, Paris, 2012.
DOSSIER
Frédéric Jacques Temple : la poésie des sept points cardinaux
Jacqueline Assaël
« Sept points cardinaux », comme la démesure ordonnée d’une œuvre-fleuve tel le Saint-Laurent, « la Grande Rivière ». Une œuvre jamais en débâcle, jamais en embâcle, pourtant, mais qui suit le cours d’un siècle, comme une « Rivière qui marche », tel le Saint-Laurent. Pierre Nepveu nous rappelle que Frédéric Jacques Temple en évoque les berges comme un passage d’oiseaux et de temps : « le temps caillé mûrit/ en secret l’avent des oies blanches/ au cap Tourmente ».
Sept points cardinaux comme les repères en quatre dimensions d’une espèce de cosmologie amérindienne dont le poète pourrait nous raconter les mythes, entre son Retour à Santa Fé et ses Psaumes de la Création des Indiens Navahos, entre son récit de voyage et son œuvre de traducteur, c’est-à-dire de passeur de culture.
Il est difficile de suivre Frédéric Jacques Temple, toujours ailleurs. En ce mois de mai, le festival Les étonnants voyageurs ne l’a pas invité à Saint-Malo sans quelque pertinence ! Dans la géographie de son œuvre écartelée comme une rose des vents, il se retrouve : « loin, je suis près des origines », espace et temps confondus. On sait sa soif de départs et de retours. Elle a été analysée par les critiques littéraires, notamment dans un colloque joliment et judicieusement titré « Frédéric Jacques Temple, l’aventure de vivre ». Pourquoi y revenir ? Sans doute parce qu’il est fascinant de suivre ses traces poétiques, non seulement dans la forêt laurentienne, avec Pierre Nepveu, mais aussi à travers la densité d’une minuscule Odyssée que lui consacre Joan-Claudi Forê, pour le nommer avec l’exotisme sans apprêt de sa langue occitane, ou à travers les filigranes de ses traductions d’amitié vénitienne dont le commentaire de Christine Amiech révèle la fusion alchimique des couleurs : « car le noir aussi est de l’or ». Sans doute parce que la richesse de ses impressions de voyage n’est jamais épuisée et que sa poésie devient notre voyage, non pas d’un saut d’avion, mais à partir d’une plongée dans la rareté, bien plus exquise, d’un regard poétique sur le monde.
Car la lecture de Frédéric Jacques Temple propose de fréquenter une vie, dont la proximité amicale de Jacques Lovichi suggère tout le côté attachant, dont le poète lui-même laisse filtrer par ailleurs quelques caractères et événements âpres et accidentés, et qui installe l’art comme exigence de la communication entre les hommes.
En poésie, Frédéric Jacques Temple représente une figure étrange dans un siècle de recherches hermétiques et de murmures ténus. Car son œuvre est généreuse et son expression sans plus de mystère que celui du rêve inspiré qu’elle fait naître. Mais Christine Amiech a souligné son anachronisme, en quelque sorte, en mettant en exergue le lyrisme de son esthétique, et Jacques Lovichi a réhabilité l’évidence poétique en s’émerveillant de la simplicité concise, claire et inventive de Temple. Oui, une œuvre étrange et majestueuse, comme un monument vivant qui demeure et s’inscrit dans la nature d’un paysage de l’esprit.
Il est bien de devenir nonagénaire, car le fleuve traverse alors des continents. Repérant les lumignons de tels anniversaires, le monde littéraire braque alors un peu plus vivement son projecteur sur l’œuvre féconde, déjà pleinement reconnue. Nunc, « maintenant », ne pouvait donc pas manquer de participer à cette célébration et à cet hommage, car la voix de Frédéric Jacques Temple fait retentir avec amplitude, depuis quelques décennies, les accents très personnels d’une recherche poétique qui se porte aussi vers le point cardinal du zénith. Le ciel. Ah ! oui, le ciel. Dieu, donc. Je n’y reviens pas. Il suffit de lire, Nunc.
Et cependant : « le temps caillé mûrit/ en secret l’avent des oies blanches/ au cap Tourmente ». Ne lisez-vous pas dans ces vers, en plus de la finesse de la métaphore gustative autour des nuances laiteuses et nourricières de la nature, toute la sensibilité subtile de Frédéric Jacques Temple aux variations les plus infimes des consistances et de la matérialité de l’être ? un plein attachement, de toutes ses fibres de poète ? et une infime dérision, un brin d’humour tout au moins, pour cette annonce de la démiurgie du Temps qui, bousculant les hommes, dans l’orage, ne leur envoie que l’angélisme des oies blanches ?
Dossier consacré à : TEMPLE Frédéric Jacques