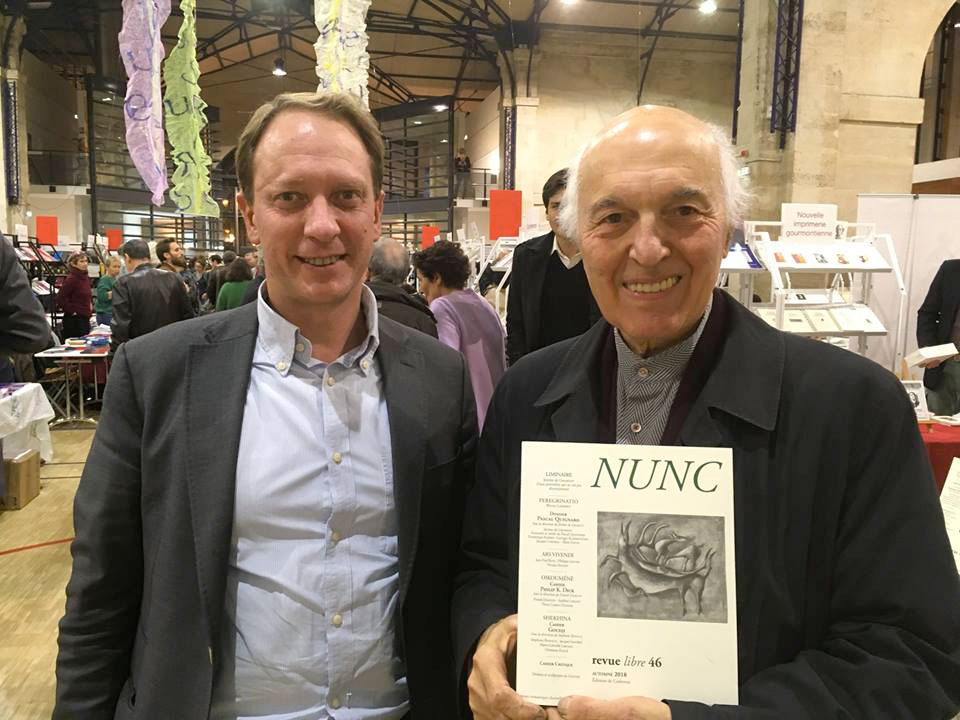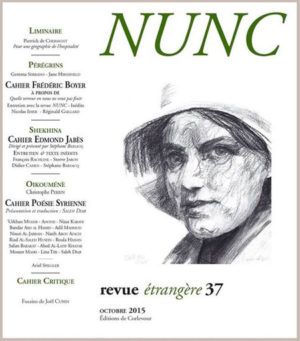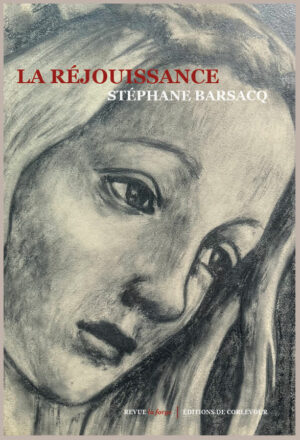SOMMAIRE
Dessins et sculptures de Goudji
Liminaire
Jérôme de Gramont D’une parenthèse qui ne soit pas divertissement
Peregrinatio
Werner Lambersy Le Grand poème (2014-2018)
Dossier : Pascal Quignard
Sous la direction de Jérôme de Gramont
Jérôme de Gramont Introduction
Pascal Quignard Les deux vies
Jérrôme de Gramont L’imminence du nom
Pascal Quignard Naître au langage. Entretien
Dominique Alibert Langues, mots et fin des temps : autour des Larmes de Pascal Quignard
Georges Kliebenstein L’oubli du mot-nom
Jacques Cheneau Une fleur à la boutonnière de la bouche : Vergissmeinnicht
Alain David Questions phénoménologiques à Pascal Quignard
Ars vivendi
Jean-Paul Bota Le Piéton nantais
Philippe Leuckx Al di là della muraglia
Nicolas Dutent Poèmes
Oikouménè
Cahier « Being Philip K. Dick »
Sous la direction de Franck Damour
Franck Damour Introduction
Aurélien Lemant Un lit cassé sur la planète MOI
Pierre Cassou-Nogues Descartes et Dick
Franck Damour Le rêve de Rachel
Shekhina
Cahier « Goudji »
Sous la direction de Stéphane Barsacq
Stéphane Barsacq Introduction
Jacques Santrot Goudji en Colchide
Stéphane Barsacq Goudji dans le reflet de Byzance
Marie-Gabrielle Leblanc Goudji, la liturgie de l’éternité
Christiane Rancé Goudji, L’art et son mythe
Cahier Critique
Les auteurs
LIMINAIRE
D’une parenthèse qui ne soit pas divertissement
Disons des choses non-calmes – il le faut. Il importe de ne pas être dupe de la poésie. Rien ne paraît facile comme de jeter sur l’existence un vêtement de mots et de phrases, qui plaisent assurément et, le temps d’un poème, nous distraient de la peine de vivre. Les mots, les plus beaux mots, pourtant n’effaceront pas la dureté de l’être et les violences de l’histoire. Ne pas les voir pourrait relever, pour nous de la plus plate cécité, mais pour les autres de la plus impardonnable faute politique. Il est des misères que seuls les corps peuvent panser. Il s’agit d’être lucide avant de dire des choses belles. Laissons monter la plainte des hommes, ne la recouvrons pas : elle est la matière de l’histoire. Que ne soient pas étouffées ces paroles qui doivent être les premières. Lesquelles ?
Au commencement est la merveille des merveilles de l’il y a : terre et ciel, pierres et vivants, sable et neige, hommes et étoiles, les hommes surtout en leurs visages multipliés – tout ce qui soulève le regard dans l’exclamation qui bientôt se fera poème. Mais au commencement aussi est l’insupportable qui appelle le cri. Au commencement est l’injustice qui passe avant le commencement. De quelle vérité la poésie est-elle dépositaire si elle tait cette clameur, si elle renonce à voir le malheur, le mal, autrement dit si elle choisit de ne voir que le bonheur ou le confort qui se fait passer pour le bonheur ? Rien n’est facile – au moins pour certains, est-ce que cela veut dire pour nous ? – comme de consentir au monde comme il va, pactiser, gérer, les hommes comme les choses – n’est-ce pas la nouvelle définition de la politique ? Rien n’est salutaire comme de refuser, résister, ou même simplement ouvrir au milieu d’une histoire qui a sa loi et ses tourments de fragiles parenthèses.
Parenthèse – le mot mérite qu’on s’y arrête plus que son sens obvie ne semble le demander. Le mot, et ces quelques lignes prises à une lettre de Gisèle Celan adressée à René Char : « La mémoire fait un choix, souvent infidèle et ne garde que le moins douloureux, rejetant l’insupportable. Avoir le courage de vivre avec la vérité entière ! La vie me semble par moments si injuste et méchante. Cette solitude, cette quête incessante, cette marche pressée, affamée des êtres qui peuplent la terre, anxieux, je sais que c’est le sort des hommes. Avec par moments comme des parenthèses de joie, de rencontre, d’amour, qui permettent de respirer, qui justifient tout le reste1. »
Paroles terribles, qui nous jettent au milieu de l’insupportable, comme un écho à l’aveu de Cézanne : « C’est effrayant la vie ! », n’étaient les derniers mots, à peine écrits à la faveur d’une simple parenthèse : la joie, les rencontres, l’amour. N’était ce décompte illogique où quelques instants de joie valent plus que toute une histoire de désastre. Une parenthèse compte plus que tout le cours de l’expérience où elle s’insère. Comme une phrase pèse plus qu’un livre entier, même le livre ouvert où elle a lieu. Comme une simple rencontre a plus de valeur à nos yeux que le monde entier où elle prend place. Comme un acte de charité sur cette terre a plus de noblesse que l’éternité de la vision des bienheureux dans la Jérusalem céleste (ce paradoxe est défendu au XIVe siècle par Gonzalve d’Espagne lors d’une dispute avec Maitre Eckhart qui n’était pas lui-même avare en paradoxes2). Une parenthèse d’amour ne nous donne pas seulement la force de vivre ou de survivre, elle justifie tout parce qu’elle rend justice au monde en l’arrachant à son cours. Au moins un instant. Là, aujourd’hui, nunc.
Parenthèses – le même mot, au pluriel, apparaît sous la plume de Jean-Yves Lacoste au § 21 de son grand livre Expérience et Absolu (« L’histoire entre parenthèses »). Le contexte est autre assurément, ou provisoirement autre (est-ce qu’il ne nous appartient pas, lecteurs, de réaliser un jour la fusion des contextes ?), celui d’une phénoménologie de la liturgie. Tâchons de ramasser en deux ou trois mots ce qui demanderait de bien plus patientes explications. Il y a une logique de l’être-au-monde qui a pour horizon en dernier lieu la mort (il revient à Martin Heidegger de l’avoir décrite en 1927), comme il y a une logique de l’histoire qui a pour noyau l’incessant combat des maîtres et des esclaves (sur ce lien entre violence et histoire Hegel a dit ce qu’il fallait). Mais il y a surtout une manière de subvertir cette double logique afin d’exister non pas hors du monde mais dans ses marges, forcément dans l’histoire mais dans ce qui prend nom entracte. Celui qui prie et se tient coram Deo ne cesse pas d’être au monde et dans l’histoire, mais il y est autrement : il l’est liturgiquement, et c’est l’œuvre de la liturgie précisément que de défaire le travail de l’histoire et la mettre entre parenthèses. Quelque chose s’y dit de l’eschaton sans avoir la prétention de le réaliser3.
Sans doute est-ce de plusieurs manières que nous pouvons opposer au monde comme il va la puissance d’un refus. Oui et Non sont mots les plus faciles à prononcer, mais les plus difficiles à prononcer vraiment. Il faut se donner le droit de prononcer certains mots. Que l’histoire soit livrée à la violence, Emmanuel Levinas le savait qui dans les premières pages de Totalité infini parlait de la guerre comme de la loi qui régit notre expérience de l’être comme monde, histoire et totalité. Il est bon de se souvenir ici de la toute première phrase du livre : « On conviendra aisément qu’il importe au plus haut point de savoir si l’on n’est pas dupe de la morale4 ». L’expérience de l’histoire, de la dure histoire des hommes, ne vient-elle pas réfuter les prétentions de la morale ? Tout le livre est écrit, on le sait, pour répondre à ce soupçon, et faire entendre la voix à la fois des philosophes et des prophètes5. Aux philosophes de montrer le monde comme il est, mais aux prophètes d’interrompre le train de l’être. Là encore, beaucoup serait à dire. Que chacun prolonge ce discours.
Cette urgence du Non, cette puissance du refus – appelons-la refus, révolte ou insoumission – nous aurons aussi à l’inventer ou la réinventer politiquement. Là où la justice manque, il est bon de savoir encore la manifester. (Songeons au devenir du mot « manifestation » : il a perdu son sens premier d’Apparition, et résonne aujourd’hui comme une clameur qui monte de la rue. Ce jour-là la raison perd son calme et tonne en son cratère.) Se pourrait-il que la politique soit à penser elle aussi comme une puissance d’interruption ? Non pas comme un fleuve cherchant la mer où se jeter, mais comme une succession ininterrompue de chances à saisir et de moments de liberté ? Comme autant de parenthèses qu’il faut arracher au cours homogène de l’histoire. Un penseur avait commencé de le dire au siècle dernier, quand l’histoire entrait dans son plus grand tourment. Il s’appelait Walter Benjamin, et sa pensée était nourrie de théologie (juive) et de matérialisme (historique). De la dix-septième thèse sur le concept d’histoire, je retiens ce passage, à propos de l’historien matérialiste : « Il saisit cette chance pour arracher une époque déterminée au cours homogène de l’histoire ; il arrache de même à une époque telle vie particulière, à l’œuvre d’une vie tel ouvrage particulier.6 »
Walter Benjamin, Emmanuel Levinas, Jean-Yves Lacoste, Gisèle Celan-Lestrange (donc aussi Paul Celan). J’égrène aujourd’hui leurs noms comme autant de signes et d’amers. Et maintenant ? Que faire, que penser, comment dire ? Une parole est à inventer – sans cesse à réinventer – pour dire le Oui et le Non. Il n’y a pas d’autre tâche, pas d’autres mots que ces deux-là, tout le reste est fadeur. Mais pour prononcer un mot, le prononcer vraiment, nous savons bien qu’il faut des livres entiers. Des livres, ou des poèmes.
Parle –
Cependant ne sépare pas le Oui du Non
(Paul Celan)
Il nous faut inventer une parole qui ne soit pas oublieuse des déchirements d’histoire au milieu desquels elle a lieu. Et qui sache maintenir la promesse du Oui et de sa joie. D’une joie qui ne soit pas insouciance vaine et divertissement. Qui puisse prendre appui sur les tourments de l’existence qui sont la matière même de l’existence. Qui n’oublie rien du sort des hommes, mais puisse aussi – au moins dans l’image, le poème – les confier à la joie. Il n’est pas jusqu’au Livre des livres où le Cantique des cantiques ne voisine avec la détresse du livre de Job. Toute la tâche est de prononcer le Oui et le Non, mais inégalement. Toute la difficulté est de trouver le ton. Poétiquement, musicalement.
S’il faut ne donner qu’un seul exemple, que ce soit le Don Giovanni de Mozart. Qu’on l’entende comme il l’a voulu : « drame joyeux », où la joie pure de la musique n’efface pas le drame de Don Juan. Drame joyeux, mais où l’accent se déplace du drame vers la joie. Dans le mot légèreté il y a deux accents aigus et un accent grave. Pour que la légèreté existe il lui faut aussi un peu de gravité. « Ecoutez, écoutez le Don Giovanni de Mozart » écrit Kierkegaard au seuil d’une œuvre où il sait décrire toutes les tonalités de l’existence, depuis le plus profond désespoir jusqu’à la joie la plus légère. Dans une œuvre qui s’achemine vers la joie la plus légère, celle qui appartient aux oiseaux du ciel, nos vrais maîtres.
Et s’il fallait un deuxième exemple que ce soit pour citer Le Mur, une pièce yiddish hélas connue de très peu, pièce écrite après la guerre avec des chants rescapés de ghetto, d’une beauté déchirante. Pièce d’une tristesse infinie née de l’histoire et d’où s’élève une petite joie, petite mais plus grande encore que l’infini, et prêt à l’engloutir.
Serons-nous capables de ces parenthèses d’amour qui sauvent tout ? D’inventer cette vraie légèreté qui n’est pas oubli des tourments de l’existence et de l’histoire ? D’inventer une langue pour le chant de l’existence et le cri de la justice ? Aujourd’hui c’est de poètes et de prophètes que nous avons le plus besoin7.
Alors poètes, au travail !
(1) Gisèle Celan, Lettre à René Char du 19 janvier 1966, dans Paul Celan et René Char, Correspondance 1954-1968, suivie de la Correspondance René Char – Gisèle Celan-Lestrange (1969-1977), Paris, Gallimard, 2015, p. 172.
(2) Sur cette dispute voir Jean-Louis Chrétien, Le Regard de l’amour, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 218-220.
(3) « De quelque manière toutefois qu’elle nous rend au monde et à l’histoire, la liturgie prouve la possibilité d’une suspension : elle symbolise et réalise ensemble, dans l’intervalle qui est le sien, une paix et une fraternité qui, en termes de Weltgeschichte, sont l’utopique ou l’eschatologique » (Jean-Yves Lacoste, Expérience et Absolu, Paris, PUF, 1994, p. 62).
(4) Emmanuel Levinas, Totalité et infini, La Haye, Martinus Nijhoff, 1961, p. IX.
(5) « Il est peut-être temps de reconnaître dans l’hypocrisie, non seulement un vilain défaut contingent de l’homme, mais le déchirement profond d’un monde attaché à la fois aux philosophes et aux prophètes » (ibid., p. XII).
(6) Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », trad. M. de Gandillac, dans Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 441.
(7) S’il est permis de se citer, que ce soit pour renvoyer à l’Eloge de Pier Paolo Pasolini qui sert de Liminaire au numéro 33 de Nunc (juin 2014), et à l’Epître sur l’Eglise du numéro 21 (juin 2010).